une clef pour comprendre l’émergence du christianisme
Jean V.
Ce texte est aussi disponible en format PDF.
« Mêmes causes, mêmes effets »
L’apparition de la foi rastafarienne
L’émergence en Jamaïque, en plein XXe siècle, d’une nouvelle religion, le rastafarisme, est un phénomène intéressant à plusieurs points de vue. Voir naître sous nos yeux une nouvelle religion messianique, en observer les tenants et aboutissants sociologiques, psychologiques, et l’évolution très rapide, peut servir de modèle à la compréhension de l’apparition il y a bien longtemps d’une grande religion mondiale, le christianisme, avec laquelle des parallèles intéressants peuvent être relevés.
C’est parmi les descendants des esclaves noirs des Caraïbes que vivent des mouvements afromessianiques, basés sur une certaine lecture de la Bible, en particulier les deux grands événements vétéro-testamentaires que sont l’Exode et le retour de l’exil babylonien. Des prédicateurs protestants appliquent ces grands mythes bibliques à la situation des Afro- Caribéens. L’esclavage est assimilé à l’oppression égyptienne, l’éloignement de la terre africaine l’est à la captivité babylonienne, les Noirs antillais et américains sont les nouveaux Israélites que Dieu libèrera bientôt de l’oppression. Le retour en Afrique est rêvé, ce sera une libération, les descendants d’esclaves, dont la condition matérielle et morale est plus que misérable, seront bientôt arrachés à la pauvreté et à l’oppression. Plusieurs mouvements messianiques inspirés, de près ou de loin, des mythes bibliques, donnent ainsi de l’espoir à ces populations qui vivent dans la plus grande pauvreté.
Un de ces prédicateurs, le Jamaïcain Marcus Garvey (1887-1940)[1], joint à la prédication un activisme politique qui lui vaut bien des ennuis avec l’autorité. Fondateur de plusieurs associations militantes, le voilà qui fait souvent référence dans ses discours à l’Ethiopie, seul Etat africain à être resté indépendant. L’Ethiopie, culture ancienne et prestigieuse, démonstration que les Africains aussi sont capables de grandes réalisations. On attribue à Garvey la « prophétie » des années 1920 qui annonce que bientôt sera couronné en Afrique un grand roi qui rapatriera les exilés. “Regardez vers l’Afrique, où un roi noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance”. Peu après cette déclaration a lieu le couronnement du prince Ras Tafari Makonnen, sous le nom de Haïlé Sélassié (Puissance de la Trinité !), qui assume les titres de « Roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda ». Les garveyites jamaïcains ont alors vite fait de feuilleter leur Bible et de retrouver ces titres appliqués au Christ dans le livre de l’Apocalypse… et c’est le départ de la religion rastafarienne !
Petit à petit, dans les collines de Jamaïque, s’organisent des camps habités par les premiers ascètes jamaïcains, qui attendent fiévreusement l’arrivée des bateaux que l’Empereur doit envoyer à travers l’océan pour rassembler les élus. Méprisés des hautes classes de la société, souvent blanches, les Rastafariens, adorateurs de Jah (version anglicisée de Yhwh, le Dieu de la Bible, nom sous lequel ils désignent l’empereur d’Ethiopie) ont un impact certain sur les populations des ghettos urbains, et petit à petit le groupe grandit… La visite officielle de l’Empereur en Jamaïque (1966) est l’occasion pour eux de manifester leur foi et leur espérance, au grand étonnement de l’intéressé lui-même, qui ne savait pas qu’en cette île lointaine existe une secte qui le divinise. Touché par les nombreuses manifestations de foi et d’affection, il décide même d’organiser des oeuvres de bienfaisance dont bénéficieront les pauvres de Jamaïque, et offrira aussi des terres en Ethiopie où pourront s’installer quelques heureux élus, qu’on croit les premiers rapatriés, les premiers citoyens du paradis ! Mais c’est sa rencontre avec la musique populaire jamaïcaine qui vaudra au rastafarisme une reconnaissance mondiale. Un des premiers musiciens rastafariens est Don Drummond, le génial tromboniste des Skatalites, décédé en 1969. Suivront beaucoup d’autres, au premier rang desquels Bob Marley, mais aussi Burning Spear, Ras Michael (religieux rastafarien dont le groupe s’appelle « Sons of Negus ») et beaucoup d’autres héros du reggae des années 1970.
Le culte rastafarien est à vrai dire peu organisé. Ce n’est pas une secte centralisée, mais plutôt une nébuleuse de groupuscules et de mouvements, chacun avec son emphase religieuse particulière. Les traits communs de ces mouvements sont la lecture de la Bible dans une perspective africaine (assimilation des Noirs d’Amérique et des Caraïbes au peuple d’Israël), l’adoration de Haïlé Sélassié, Dieu apparu sur terre pour rapatrier les Noirs en Afrique, l’adoption d’un régime végétarien, la consommation de cannabis vu comme un sacrement, moyen de communiquer avec « Sa Majesté » et de s’ouvrir à son influence. Certains mouvements se différencient les uns des autres quand il s’agit de définir une attitude par rapport aux Blancs : les Nyahbinghi prônent un salut réservé uniquement aux Noirs, seul peuple élu, les Twelve Tribes of Israel (dont font partie Bob Marley, Jacob Miller et beaucoup d’autres) accueillent en leurs rangs des Blancs… Le mouvement Bobo, quant à lui, rassemble ses fidèles autour d’un « prophète » du nom de Prince Emmanuel, figure autoritaire qui n’hésite pas à se proclamer Dieu à l’égal de l’empereur d’Ethiopie, créant ainsi une nouvelle Trinité composée de l’empereur, de Marcus Garvey et de lui-même. Enfin les « Jesus Dread » mettent l’accent sur la parenté de leur mouvement avec le christianisme (le musicien Yabby You en est un des représentants les plus célèbres) : pour eux, Haïlé Sélassié est le Christ revenu sur terre, ce même Christ dont la mort sur la croix pardonne les péchés, comme l’interprètent aussi les protestants baptistes et pentecôtistes – l’aspect « africaniste » est chez eux quelque peu atténué. Ainsi, à peine un demi-siècle après la « prophétie » de Garvey et le couronnement de l’empereur d’Ethiopie, le mouvement est déjà devenu une nébuleuse de chapelles, chacune avec son message différencié.
Un événement très important dans l’évolution de l’idéologie rastafarienne est le coup d’Etat de 1975 en Ethiopie. Le colonel Mengistu Haïlé Mariam renverse l’empereur, qui est mis à mort le 27 août 1975, et établit un régime communiste pro-soviétique en Ethiopie. Cela ne va évidemment pas sans répercussions au sein des communautés rastafariennes de Jamaïque. Le déni est immédiat : non, l’Empereur n’est pas mort puisqu’il est divin, il continue d’exister de manière cachée et reviendra très bientôt. Ce qui se passe n’est qu’une épreuve imposée aux croyants pour éprouver leur foi. Bob Marley monte au créneau avec une sublime chanson intitulée « Jah Live », dans laquelle il paraphrase le quatorzième psaume biblique :
Fools say in their heart
Rasta your God is dead…[2]
On rencontre les mêmes convictions dans la chanson « Jah no Dead » enregistrée en 1978 par Burning Spear (de son vrai nom Winston Rodney) :
They tried to fool the black population
By telling them that Jah Jah dead
I and I know that Jah no dead…[3]
Tout est dit : l’annonce de la mort de Sa Majesté Impériale est un complot du monde colonialiste visant à décourager les croyants, mais ceux-ci sont appelés à garder la foi et l’espérance, car bientôt Haïlé Sélassié, Dieu vivant, se révèlera et conduira les élus persévérants en Afrique… Les différents mouvements rastafariens en sont toujours là aujourd’hui, plus d’une trentaine d’années plus tard, et le rastafarisme continue de recruter des membres à travers le monde, à grand coups de rythmes reggae et de consommation de marijuana…
Et le christianisme ?
La religion rastafarienne, ou plutôt cette nébuleuse, n’est pas sans intérêt pour étudier les mécanismes sociologiques et psychologiques de la naissance d’une religion messianique. Reprenons quelques éléments : (1) un terreau fait de désespoir et d’oppression, (2) une lecture des textes bibliques qui apporte un espoir centré sur la figure d’un sauveur, (3) un désespoir tel que même la mort du « sauveur » ne décourage pas les croyants, qui se mettent à trouver des explications et attendent son retour. Ajoutons-y par la suite (4) l’effloraison de multiples mouvements, chacun avec sa tonalité particulière et sa plus ou moins grande ouverture ou adaptation à la réalité.
Le parallèle avec le christianisme n’est pas difficile à établir. Les conditions de vie du peuple juif du premier siècle de notre ère sont fort semblables à celle des descendants d’esclaves noirs des Caraïbes. La misère matérielle, des conditions de vie difficile, l’oppression romaine, la perte d’identité culturelle due à la domination étrangère… Dans un tel contexte sont apparus de multiples mouvements insurrectionnels qui ont connu plus ou moins de succès parmi la population et ont tous été réprimés par les Romains. Le Nouveau Testament aussi bien que les historiographes de l’antiquité en font état. Au milieu de tout cela, la lecture de la Torah et des Prophètes fait miroiter au peuple juif l’espoir de l’apparition du Messie, libérateur envoyé par Dieu, qui rendra à la nation sa dignité, sa prospérité, sa liberté.
Il est, d’un point de vue historique, difficile de savoir qui était vraiment Jésus de Nazareth. Il est à peu près certain que le personnage a existé, qu’il a marqué son temps, qu’il a suscité des remous d’ordre politico-religieux qui lui ont valu sa crucifixion par les Romains. Le plus ancien des évangiles reconnus comme canoniques par les Eglises chrétiennes, celui de Marc, est généralement daté des années 60, soit une trentaine d’années après la crucifixion du rabbi galiléen (ceux de Matthieu, Luc et Jean sont plus tardifs, leur rédaction ayant pu s’échelonner jusqu’à la fin du Ier siècle, voire le début du IIe). On vient de le voir avec le mouvement rastafarien, en quelques décennies il peut se passer bien des choses, une image peut se construire, une mythologie se mettre en place, et les chapelles peuvent se diversifier. Il semble bien que ce soit ce qui s’est passé. A dire vrai, nous disposons d’écrits chrétiens plus anciens que les évangiles, il s’agit des épîtres de Paul de Tarse, elles aussi recueillies dans le Nouveau Testament, et dont les plus anciennes datent des années 50 — soit déjà plus de vingt ans après la mort de Jésus. Tous ces écrits, notons-le bien, sont des écrits engagés : leur but n’est pas de nous raconter froidement, objectivement, ce qui s’est réellement passé, comme le ferait un historien après consultation critique de sources contradictoires. Ce sont des écrits de combat, dont le but est de gagner de nouveaux fidèles au christianisme naissant, et de renforcer la conviction de ceux qui ont déjà été gagnés. Ils nous apprennent très peu sur la vie réelle du Jésus historique, mais nous renseignent abondamment sur la perception qu’avaient de lui les premiers chrétiens — tout comme les chansons de Bob Marley et des autres n’ont rien à nous apprendre sur la vie réelle de Haïlé Sélassié mais fourmillent d’informations sur la foi des rastafariens et les questions qui se posent à eux.
Les épîtres de Paul ne racontent pas la vie de Jésus comme le feront plus tard les évangiles, fût-ce de manière engagée et nimbée de surnaturel. Paul, cet étrange personnage qui s’est autoproclamé apôtre suite à une vision du Christ ressuscité, se donne dans ses écrits la mission de révéler un sens à la mort de Jésus. L’entreprise est intéressante et symptomatique, car au fond, il s’agit de donner du sens à ce qui n’en a pas. Tout le défi est là, et le travail d’élaboration d’une mystique de la mort et de la résurrection de Jésus est réellement fondateur de l’idéologie religieuse chrétienne, et influencera nombre d’écrits subséquents, dont les évangiles canoniques. En bref, l’idée lumineuse de Paul est la suivante : la mort de Jésus était un sacrifice expiatoire pour le péché au bénéfice de ceux qui croient et s’agrègent par le baptême à l’assemblée des croyants — l’Eglise — et reçoivent la vie de résurrection qui les rend capables de plaire à Dieu et d’entrer dans la vie éternelle. Cette mystique sera reprise dans les autres écrits du Nouveau Testament et est, encore aujourd’hui, à la base de ce qu’on nomme le christianisme.
Mais qui lit attentivement les écrits de Paul et s’initie à la littérature ancienne des chrétiens se rend vite compte que l’interprétation que Paul donne de Jésus n’est pas la seule. Paul luimême, dans ses textes, est souvent engagé dans une polémique avec des adversaires qui lui donnent du fil à retordre et paraissent avoir un certain succès. Si Paul et le Nouveau Testament représentent l’interprétation proto-orthodoxe de Jésus, on peut déceler dans ses écrits l’existence d’au moins deux autres courants qui nous sont aussi connus par la littérature subséquente : le judéo-christianisme et le gnosticisme.
Paul bataille ferme contre les judéo-chrétiens : pour ceux-ci, l’essentiel est l’observance de la Torah, que Jésus est venu revivifier en révélant son sens intérieur et ses exigences profondes. Le mouvement chrétien n’est qu’une chapelle à l’intérieur du judaïsme, la circoncision et les observances juives (ou une certaine lecture de celles-ci) restent indispensables au salut — alors que pour Paul, les observances ne sont rien, c’est la foi au Christ immolé et ressuscité qui est tout, que l’on soit d’origine juive ou non. Si l’on ne connaît les adversaires de Paul qu’à travers les écrits de celui-ci, ils auront une descendance qui, plus tard, produira des écrits nous permettant de mieux appréhender leur pensée. Au premier rang de ceux-ci figure ce qu’on appelle le roman pseudo-clémentin. Dans cette littérature dont les plus anciens éléments peuvent remonter au IIe siècle, se dégagent plusieurs idées maîtresses qui feront fortune. Les judéo-chrétiens semblent faire l’impasse sur la crucifixion de Jésus : ce qui compte, c’est son message. La Torah écrite a été falsifiée par de multiples adjonctions (les « fausses péricopes ») et Jésus est venu corriger le tir en restaurant le message originel, ce qui fait de lui le « prophète de vérité » — on n’est pas loin du tahrîf de la théologie islamique, et pour cause. Avec le Jésus des écrits pseudo-clémentins, c’est un judaïsme dépouillé du culte sacrificiel qui est révélé ou restauré, un judaïsme dans lequel comptent en premier lieu l’adhésion au Dieu unique et l’observance des commandements de moralité et de pureté. Ces idées feront leur chemin, le courant judéo-chrétien se diversifiera lui-même en plusieurs groupes qui se feront marginaux avec l’émergence du christianisme constantinien — celui de Paul devenu religion d’Etat au IVe siècle. Le judéo-christianisme survivra aux frontières de l’Empire byzantin, en particulier parmi les tribus arabes, et connaîtra un événement majeur au VIIe siècle : un petit groupe judéo-chrétien réussira la fusion de ses croyances et pratiques avec des coutumes spécifiquement arabes et se lancera à la conquête du monde par la guerre sainte : entreprise qui n’a rien de surprenant ou d’exotique quand on a lu l’Ancien Testament, qui reste la base sur laquelle, consciemment ou non, tout se construit dans les monothéismes moyen-orientaux…
L’islam, car c’est bien de lui qu’il s’agit, trouve ses racines lui aussi dans une interprétation ancienne de Jésus. Le rabbi galiléen se voit ici le prédécesseur de Mahomet en ce que les deux ont eu la même mission : dépoussiérer la religion de ses interprétations abusives et de ses déformations, restaurer le culte du Dieu unique dans toute sa simplicité, faite de prière, de charité et d’observances pieuses. Quant à la mort de Jésus, elle est tout simplement éludée : à la suite du docétisme de courants plus anciens — encore une idée qui n’est donc pas neuve en islam — la mort de Jésus était une illusion, il n’a pas vraiment été tué mais enlevé auprès de Dieu, d’où il reviendra à la fin des temps.
L’apparition de l’islam fait encore l’objet de recherches ardues du côté des historiens : en effet, reconstituer les véritables événements fondateurs est très difficile quand les premières vies du prophète Mahomet datent, non de quelques dizaines d’années, mais de plus d’un siècle après les faits. En effet, la Sîra d’Ibn Hishâm, premier récit complet qui nous soit parvenu, est datée de l’an… 218 après l’Hégire, soit 834 de notre ère, et repose sur un écrit perdu, la Sîra d’Ibn Ishaq, qui daterait de 150/767 — on le voit, l’écart temporel entre les événements et les premiers écrits est impressionnant, et laisse tout le temps à une légendologie orale de se développer, encore bien plus que pendant les trente ans qui séparent la mort de Jésus de la rédaction de l’évangile de Marc ! Quoi qu’il en soit, l’important n’est pas dans l’événementiel. Ce qui compte, c’est, au-delà des vicissitudes de son histoire et de ses réinterprétations, la préservation par l’islam d’un message et d’une pratique cultuelle qui remontent bien au-delà de son émergence en tant que tel : Jésus, messager divin venu restaurer la foi originelle comme plus tard le fera Mahomet; la circoncision, les interdits alimentaires qui restent d’application; la guerre sainte, moyen de propager la vraie religion, et qui, loin de l’image idéalisée qu’on se fait de lui en occident, faisait très probablement partie du message de Jésus, comme nous le verrons plus loin; enfin, la crucifixion, expliquée comme une substitution, une illusion, et surtout comme une péripétie sans réelle importance, plutôt que comme l’événement de salut par excellence.
Nous avons déjà survolé deux des trois courants auxquels Jésus — probablement bien malgré lui — a donné naissance. Il y a le christianisme paulinien, qui avec le temps deviendra le christianisme tout court, religion dans laquelle est offerte une explication à l’inexplicable : la mort de Jésus, loin d’être la fin d’un espoir, est un sacrifice rédempteur pour toute l’humanité à qui le salut est offert moyennant l’adhésion à l’Eglise, la foi en Jésus, l’initiation aux mystères (qu’on appelle aujourd’hui les sacrements); et il y a le judéo-christianisme, qui deviendra plus tard l’islam : Jésus était un messager divin, il est venu débarrasser la religion d’accrétions d’origine humaine, restaurer la pureté de la foi et de la pratique d’un monothéisme originel, et lorsque son message a été délivré, il a été sauvé in extremis de la mort par Dieu qui l’a enlevé auprès de lui. Dans l’un et l’autre cas, on remarquera que c’est sa mort en croix qui pose problème, et qui fait l’objet d’une explication mystique d’un côté, d’un déni pur et simple de l’autre. Au moins peut-on être sûr de ceci : si Paul et ses adversaires, malgré leur virulente opposition, éprouvent le besoin de résoudre un problème, certes par des voies radicalement différentes, c’est que ce problème s’est véritablement posé. Si une chose est certaine à propos de Jésus, c’est qu’il a été crucifié !
Mais les judéo-chrétiens n’étaient pas le seul groupe auquel le paulinisme ait dû s’opposer. Dans ses épîtres, Paul bataille aussi contre un autre courant qui semble mêler Jésus à des enseignements ésotériques, une sagesse pour initiés telle qu’il en existait dans le monde moyen-oriental du premier siècle. On aura vite fait, à la lecture des quelques passages pauliniens,[4] d’identifier les ancêtres d’un autre courant de pensée qui a connu un certain succès : le gnosticisme. Ici, il ne s’agit pas de sacrifice pour les péchés, ni de restauration de la Torah originelle, mais bien plutôt d’une connaissance de soi-même et de l’univers divin censée procurer le salut aux initiés. Tracer ici un portrait des différents courants gnostiques prendrait beaucoup trop de place, la recherche n’en a d’ailleurs pas fini d’éplucher des textes récemment découverts. Quoi qu’il en soit, Jésus apparaît ici non comme l’agneau sacrifié du christianisme ou le prophète réformateur du proto-islam, mais comme un maître de sagesse. C’est cette sagesse ésotérique qui procure le salut à ceux qui acceptent l’initiation, et, selon les courants, cette sagesse comprendra plus ou moins d’éléments bibliques, hellénistiques, égyptiens, etc… De même, la mort en croix de Jésus fera l’objet de multiples lectures : soit on se rapprochera, selon les courants, de l’un ou l’autre des deux précédents, soit on la passera tout simplement sous silence — à cet égard, la lecture de l’évangile selon Thomas est révélatrice : ce texte est une collection de paroles attribuées à Jésus, mais ne dit tout simplement pas un mot de la crucifixion, alors que les évangiles de l’Eglise la racontent avec force détails puisqu’elle est au coeur de leur vision du monde et du divin.
Les courants gnostiques ont-ils cessé d’exister ? On perd leur trace peu après l’établissement du christianisme comme religion d’Etat au IVe siècle, mais là encore, des survivances marginales ont pu exister plus longtemps. Sans être connaisseur en la matière, on doit quand même relever que la tentation de l’ésotérisme semble bien vivace au sein de certaines dissidences de l’islam chiite (ismaéliens, alaouites, druzes…), mais est-ce par transmission directe ou par un développement autonome, interne au chiisme ? Ou encore un « air du temps » qui a contaminé celui-ci en trouvant un terrain favorable dans la dévotion aux imams, voire en se protégeant délibérément de la persécution en habillant de vêtements nouveaux, islamiques, ses doctrines anciennes ?
Le problème du Jésus historique
Mais qu’en est-il de l’événement fondateur qui a donné lieu à tout ce foisonnement ? Revenons-en à Jésus et aux textes qui sont censés nous le présenter : les évangiles de l’Eglise. D’emblée, précisons que notre approche sera celle de la critique historique rationnelle : on ne construit pas l’histoire avec du surnaturel, ni sans tenir compte du caractère engagé des textes, c’est-à-dire du fait qu’ils ont une idéologie à défendre, voire à imposer. Dans leur ensemble, ces textes nous font le portrait de Jésus en le présentant comme Dieu venu sur terre pour sauver l’humanité à grands coups de miracles et de déclarations pieuses, ce qui en rend une grande partie sans intérêt pour ce que nous cherchons à découvrir. Mais ici et là, des souvenirs très anciens, authentiques, se sont glissés ou se sont préservés, qui nous montrent une autre image, sans doute plus proche de la réalité. Les écrivains ne voient pas qu’en les préservant, ils introduisent dans leur plaidoyer pour le Jésus de l’Eglise des éléments qui nous mettent sur la piste du vrai Jésus, celui de l’histoire.
Curieusement, les chrétiens ont toujours été gênés aux entournures par les passages évangéliques où Jésus se montre violent, que ce soit en actes ou en paroles. Il y a, bien sûr, ce qu’on appelle pudiquement la « purification du Temple » : Jésus arrive à Jérusalem, se rend au Temple où le peuple juif célèbre le culte ancestral basé sur les sacrifices animaux, et là, scandale : « Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple, il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le Temple » (Marc 11.15-16). Pour un Sauveur qu’on présente comme doux, non-violent et respectant la liberté de chacun, le moins que l’on puisse dire est que la chose est étonnante. A moins qu’on ait ici, justement, un souvenir du vrai Jésus, qui n’était pas si commode que cela, et n’hésitait pas à recourir à une certaine violence bien deutéronomique pour faire observer la Loi divine. De tels passages, qui ne se laissent pas facilement intégrer au discours chrétien sur Jésus, sont des plus intéressants pour l’objet de notre recherche. Le rabbi galiléen s’apparente ici à un théocrate fanatique, qui n’hésite pas à braver le consensus mou de la société juive, laquelle s’accommode de la présence romaine et du principe de réalité selon lequel, si quelqu’un veut offrir un sacrifice à Dieu, c’est lui rendre service que de lui offrir le choix de la marchandise sur place !
Prenons encore cette parole de Jésus : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée » (Mt 10.34). Parole qui mettrait bien mal à l’aise les paroissiens venus à l’église fêter Noël, occasion annuelle de pontifier béatement et d’émettre des voeux pieux sans lendemain au sujet de la paix universelle supposément apportée par le divin enfant. Avec cette parole, Jésus détruit cette douce mythologie : il avait parfaitement conscience, quant à lui, d’avoir une oeuvre à accomplir, une oeuvre qui ne se ferait pas sans verser du sang. Et en tout cela, il est parfaitement en accord avec les Ecritures juives, et en particulier la Torah. Dans ces deux passages évangéliques que nous venons de citer, Jésus révèle clairement ses intentions : il faut recourir à la violence pour faire respecter la Loi de Dieu sur terre, et lorsqu’il parle d’épée, il est bien clair pour quiconque connaît le langage biblique qu’il s’agit de guerre sainte, de massacre (aujourd’hui encore, dans les dialectes araméen modernes, sayfo peut signifier « épée » mais aussi « génocide »…). On pourrait aussi citer cette étonnante parole de Jésus à ses disciples le soir de son arrestation : « Que celui qui n’a point d’épée vende son vêtement et achète une épée » (Luc 22.36). Autrement dit : c’est le moment de passer à l’action !
Nous venons de citer un passage tiré du récit du soir de l’arrestation dans l’évangile de Luc, nous continuerons avec le même récit, un passage des plus étranges. « Ils dirent : Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit : Cela suffit. » (Luc 22.38). Nous sommes le soir de l’arrestation de Jésus, il vient de célébrer la dernière Pâque avec ses disciples et va se diriger vers le Jardin des Huiles (Gath-Shemânê) où il va prier avant d’affronter son destin. Ses disciples, sentant que l’heure va être violente, lui proposent deux épées. La réponse de Jésus dans le texte grec est ambiguë. Elle est d’ordinaire comprise comme une protestation de non-violence : « Cela suffit ! » est interprété : « Arrêtez de vous préparer au combat, mon oeuvre est pacifique, je ne veux pas de cela ! ». Mais on peut comprendre tout à fait autrement, et c’est d’ailleurs ce que font de très anciennes traductions orientales, au premier rang desquelles la vetus syra, ancienne traduction syriaque pouvant dater du IIe siècle, traduction reprise telle quelle par la peshitto, révision ecclésiastique du Ve siècle, et ensuite par des traductions arabes (chrétiennes !) médiévales. Ces différentes versions anciennes ne traduisent pas par « cela suffit » mais par « elles suffisent » ou « elles suffiront ». Si l’on suit ce texte-là en réfléchissant aux conditions de l’époque, comment peut-on comprendre ce que dit Jésus ? C’est très simple : ne l’oublions pas, nous sommes à Jérusalem, sous l’occupation romaine, c’est la fête de la Pâque, grande célébration non seulement religieuse, mais aussi patriotique. Conformément aux prescriptions de la Torah, toute la population du pays s’est déplacée et se retrouve dans la ville sainte. La foule est compacte et surchauffée par la misère, elle est dans l’attente d’un mouvement messianique qui réalisera le message de la fête : Dieu libère son peuple. D’ailleurs, chaque année, le gouverneur romain, qui réside à Césarée sur la côte méditerranéenne, vient s’installer à Jérusalem pour surveiller la fête de plus près, car l’on sait qu’elle est propice aux soulèvements. Et dans ce contexte, Jésus sait une chose : il suffira de brandir les deux épées pour que des milliers de Juifs se joignent au mouvement, chacun avec son épée, son poignard, son gourdin. Il suffit d’une étincelle, et Jésus est prêt à être cette étincelle, brandir l’épée, pousser le cri de guerre qui sera repris par des milliers de voix épuisées par l’occupation, en colère contre leur vie de peuple assujetti alors qu’il devrait être le peuple élu qui règne au nom de Dieu sur les nations, comme l’avaient annoncé les prophètes…
Jésus avait réellement une chance de réussir son coup. Les deux épées auraient suffi, en effet, les brandir aurait pu provoquer l’ultime révolte qui aurait chassé les Romains et établi la théocratie en Israël. Mais il n’en a pas eu le temps : un de ses disciples, Judas, avait prévenu l’establishment sacerdotal, favorable au statu quo, de ce qui allait se passer. On connaît la suite. Et si, aux versets 49 à 53, Jésus reproche à Pierre, puis aux soldats, l’utilisation de l’épée, ce n’est certes pas par souci de non-violence, mais pour appeler tous à l’unité : Pierre n’aurait pas dû utiliser l’épée contre le serviteur du Grand-Prêtre venu l’arrêter, les soldats du Temple feraient mieux de retourner leurs épées contre les Romains plutôt que de s’en servir pour arrêter le leader de la révolte… C’est contre l’ennemi qu’il faut utiliser l’épée, pas contre son propre peuple. Cet appel à l’unité des Juifs contre l’adversaire ne sera pas entendu, pas compris. C’est le réalisme politique qui l’emporte : Jésus sera arrêté car les prêtres savent très bien que les Romains sont les plus forts et qu’il ne faut surtout pas les provoquer. L’avenir leur donnera raison : en 70, soit une quarantaine d’années plus tard, une révolte des Juifs, aboutie celle-là, donnera lieu à une vigoureuse intervention qui laissera Jérusalem en ruines et vaudra aux Juifs de se trouver en diaspora dans le monde entier.
Excursus : le deutéronomisme, plaie de l’humanité
Mais au fait, d’où vient l’idéologie de guerre sainte que nous avons évoquée comme étant à la base de l’action de Jésus ? De la Torah, bien entendu, et en particulier du dernier des cinq livres qui la composent : le Deutéronome. Précisons tout de suite qu’à notre époque d’archéologie et d’étude littéraire des textes, il est devenu impossible d’encore adhérer à la tradition ancienne qui veut que Moïse soit l’auteur du Pentateuque. Celui-ci est d’une rédaction bien plus tardive : si Moïse est censé avoir vécu dans la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C., la Torah qui lui est attribuée est bien plus tardive dans sa rédaction finale, qui est la résultante d’un long processus de rassemblement de traditions d’origines diverses. De ces traditions, celle qui a, sans doute, le plus grand impact sur l’histoire religieuse du monde — et probablement sur son histoire tout court — est celle de l’école deutéronomiste.[5]
Le noyau du Deutéronome remonterait à l’époque du roi judéen Josias, contemporain de l’effondrement de Samarie sous les coups de boutoir de l’envahisseur assyrien. Cette tragédie historique, qui a donné lieu à moult massacres et déportation, voit le petit royaume de Judée se retrouver seul héritier des traditions israélites. Josias, qui vit au VIIe siècle av. J-C, voit là l’occasion d’assumer un rôle historique, celui de restaurateur de la grandeur et de l’unité des Israélites en ces temps difficiles. A cet effet, il fait « découvrir » un vieux livre dans le Temple de Jérusalem, sur la base duquel il va construire ses réformes politiques et religieuses : un Etat judéen bâti sur la Loi du dieu unique, qui demeure dans le Temple de Jérusalem.[6]
Il faut vraiment beaucoup de foi pour ne pas ressentir un certain malaise en lisant le Deutéronome… S’il commence par de beaux chapitres évoquant les hauts faits de Dieu qui a libéré son peuple d’Egypte, passages qui ne sont pas sans une élévation de style certaine, les choses se gâtent quand on aborde la partie législative du livre, qui commence au chapitre 12. Cette section commence par l’ordre de détruire impitoyablement les lieux de culte polythéistes (12.2-3), l’ordre de mettre à mort quiconque appelle à servir d’autres dieux (chap. 13), et non seulement cela, mais les simples croyants polythéistes doivent être mis à mort aussi (17.2-7). Il faut encore mettre à mort quiconque désobéit à un prêtre ou à un juge, ceci dans le but que le peuple ait peur et soit obéissant (17.12-13 — peut-on parler de terrorisme religieux ?). Les prophètes qui parlent pour un autre dieu doivent être tués (18.20). Les enfants qui désobéissent à leurs parents peuvent faire aussi l’objet d’une sentence de mort (21.18-21). La femme qui n’arrive pas vierge au mariage sera lapidée (22.13-21), ainsi que les adultères (22.22). Le peuple nomade de Amalek est voué au génocide (25.17-19), pure vengeance historique suite à un affrontement dans le désert, supposé avoir eu lieu du temps de Moïse. De telles prescriptions se trouvent ailleurs dans la Torah : le chapitre 20 du Lévitique condamne à mort les adorateurs de Moloc, les voyants, les incestueux, les adultères, les homosexuels…
L’idéologie deutéronomiste et son appel à éliminer tous les païens et les déviants trouve son prolongement dans les livres « historiques » de la Bible : depuis Josué et sa guerre sainte de conquête jusqu’à Elie, massacreur des prophètes de Baal, c’est une longue histoire de sang, d’intolérance et de massacres, pour que la terre que Dieu a donnée à son peuple soit pure, débarrassée de tout ce qui peut paraître contraire à la volonté divine révélée dans les commandements toraïques.
Voilà, à la vérité, ce dont rêvaient les Juifs du Ier siècle : établir ou rétablir la théocratie rêvée par l’école deutéronomiste, et ce y compris et surtout par des moyens violents, puisque la Torah précise que ceux-ci ont été voulus et prescrits par Dieu — on ne peut contrer le mal qu’avec ses propres armes, seule la violence fait avancer l’Histoire, ce qui est tout à fait à l’opposé de la mentalité moderne qui veut que l’on triomphe du mal par le bien — idée qui nous vient de ce rêveur invétéré qu’était Paul (« Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » — Rom 12.21). Le Deutéronome, source de la violence zélote, influencera Jésus qui le cite beaucoup — même si les Evangiles évitent de lui mettre dans la bouche les passages les plus violents du vieux livre. Les idéaux de guerre sainte, faut-il le dire, traverseront aussi les siècles d’exil judéo-chrétien en Arabie, pour finalement se retrouver inscrits dans le Coran et servir de justification et de moteur au Jihad. Le Deutéronome, bréviaire d’Al-Qaïda ?
Sans doute, le christianisme est mal à l’aise avec toute cette violence. Les moines orthodoxes développeront une interprétation allégorique de tels textes : le Cananéen qu’il faut combattre, c’est celui que nous avons dans le coeur. Ouf ! D’ailleurs, Jésus n’a-t-il pas lui-même fait arrêter in extremis la lapidation d’une femme adultère… dans un passage célèbre (Jn 8.3-11) mais qui pose un sérieux problème quant à son attestation, puisqu’il est absent de plusieurs manuscrits anciens et prestigieux ? De leur côté, les empereurs byzantins et les papes n’ont pas hésité à recourir à la force pour persécuter les hérétiques : le deutéronomisme, s’il est atténué dans les Evangiles, menace toujours de relever la tête dans le monde chrétien… en particulier lorsque des intégristes boutent le feu à un cinéma qui passe un film contraire à leurs convictions, ou assassinent un médecin qui pratique l’avortement !
Du côté musulman, si le Coran proclame qu’il ne saurait y avoir de contrainte en religion (2.256), il contient aussi un autre verset qui dit clairement que les croyants seront bienheureux s’ils « appellent au Bien, ordonnent le Convenable, interdisent le Blâmable » (3.100) : à partir de là, bien des excès peuvent survenir, chacun ayant reçu l’ordre de se mêler de la vie des autres… On peut mentionner encore la Sourate de la Lumière, qui s’ouvre sur un appel à mettre à mort les adultères, sans éprouver la moindre indulgence en leur faveur (24.2) : écho direct au Deutéronome qui prescrit lui aussi, plusieurs fois, de n’avoir aucune pitié pour ceux que Dieu prescrit d’exécuter…
S’il y a un livre biblique qui pèse lourdement sur l’histoire en faisant la promotion de la guerre sainte et de la peine de mort pour tous les déviants, c’est bien le Deutéronome… Je ne pouvais terminer cet article sans indiquer à mon lecteur cette source ultime de bien des misères de l’humanité !
Conclusion : à l’origine de tout, la perte de l’espoir
Mais revenons-en à Jésus, le rabbin zélote de Nazareth. Jésus avait apporté un espoir au groupe de ses disciples, à tous ceux qu’il avait croisés sur son chemin et qu’il avait appelés à l’unité, à la solidarité pour établir sur terre le Royaume tant attendu. C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre ses discours inlassablement répétés dans les Eglises : l’amour du prochain que prône Jésus est à comprendre, non comme un amour universel, mais comme une solidarité interne à la communauté qu’il veut sauver par son action messianique. Les Béatitudes sont avant tout à usage interne, et Jésus était sans doute à mille lieues de penser qu’on en ferait un message qui concernerait toute l’humanité. Un passage de l’évangile de Matthieu nous montre Jésus accédant à la requête d’un centurion (Mt 8.5-13), mais Luc vend la mèche : ce Romain était favorable au judaïsme (Luc 7.4-5), et d’ailleurs, l’histoire est absente de Marc, le plus ancien évangile, et est peut être une élaboration d’inspiration paulinienne, visant à démontrer que les non-juifs ont leur place dans l’Eglise telle que la voit Paul. C’est toujours avec réticences que Jésus se laisse aborder par des non-juifs, et plus les textes sont tardifs, plus ils peuvent être suspectés d’être influencés par la pensée de Paul.
Venons-en au fait : Jésus de Nazareth a été arrêté et crucifié. L’entreprise zélote qu’il a été à deux doigts de lancer a échoué. Est resté son message de solidarité, d’unité et d’amour, message qui, répétons-le, était à usage interne et visait à préparer le peuple juif à être uni autour de son but : l’établissement du royaume messianique par la guerre sainte, laquelle trouve ses racines dans l’Ancien Testament. Tout le reste, tout ce qui a été construit par-dessus par le christianisme, se situe dans une tout autre dimension, celle de la réaction de l’être humain face à la perte de l’espoir incarné par un « sauveur ». Lorsque Jésus est mort, il a fallu trouver des explications, il a fallu réécrire toute l’histoire, et surtout affirmer que l’espoir n’était pas mort et que le Sauveur allait revenir, qu’en attendant il fallait vivre du message qui avait été proclamé et dont on a donné plusieurs lectures : celle de Paul, qui semble s’être rallié plusieurs disciples de la première heure tels Pierre et Jean, mais aussi celle des judéochrétiens et des gnostiques, lesquels groupes, soit dit en passant, se réclamèrent eux aussi de l’enseignement de disciples authentiques de Jésus (Jacques, Thomas…).
L’apparition sous nos yeux d’une nouvelle religion messianique en Jamaïque nous permet ainsi de poser une hypothèse quant à la naissance du christianisme et, dans sa foulée, de l’islam. L’un et l’autre procèdent de l’incapacité chronique de beaucoup d’êtres humains de vivre leur condition sans un espoir qui leur soit apporté de l’extérieur. L’espoir, cette projection dans l’avenir qui nous empêche de savourer le présent et sa beauté, et nous fait miroiter des temps meilleurs qui ne viendront jamais, et pour cause…
Si notre perspective est juste, peut-être verra-t-on d’ici quelques années un nouveau mouvement sectaire nous annoncer qu’Ousama Ben Laden était le plus doux des hommes, qu’il n’est pas vraiment mort et qu’il va bientôt revenir sauver l’humanité…
Notes
- Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Garvey pour un résumé de sa biographie.
- On peut l’écouter sur http://www.youtube.com/watch?v=a8oRqXKYXvs.
- Chanson immortalisée par une merveilleuse version a cappella dans le film Rockers (1979). On peut visualiser la séquence à http://www.youtube.com/watch?v=R4Vv0Y8K2KY (si on préfère entendre la version studio, elle est à http://www.youtube.com/ watch?v=813PbQ3gxOE). Apprécions aussi le poète Jah Lion qui enchaîne de nombreux versets de Psaumes avec cette simple exclamation : « Jah Live ! », à écouter sur http://www.youtube.com/watch?v=Yrx4JQahBIY
- Notons surtout : Col. 2.18-19 où Paul dénonce un « culte des anges » après avoir décoché un trait contre le judéo-christianisme aux deux versets précédents — un coup à droite, un coup à gauche ! Et aussi I Tim 6.20-21, mise en garde dramatisée par sa position à la fin de l’épître !
- A ce propos, on lira avec profit Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman La Bible Dévoilée (Paris, Bayard, 2002) qui fait le point des connaissances actuelles sur la question.
- On peut lire l’histoire pieuse de cette « découverte » en 2 Rois 22-23.


 AFT on Twitter
AFT on Twitter Alliance Athée Internationale (AAI)
Alliance Athée Internationale (AAI) Amis et amies de Libres penseurs athées
Amis et amies de Libres penseurs athées Atheist Freethinkers
Atheist Freethinkers Canal Youtube LPA-AFT
Canal Youtube LPA-AFT LPA-AFT sur Heylo
LPA-AFT sur Heylo Rassemblement pour la laïcité (RPL)
Rassemblement pour la laïcité (RPL)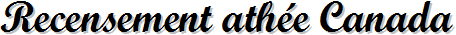 Recensement athée Canada
Recensement athée Canada