Ce texte est paru dans Le Devoir sous le titre Le PL-84 sur l’intégration nationale, une étape de plus vers la cohésion sociale.
Nadia El-Mabrouk, François Dugré, Marie-Claude Girard, Etienne-Alexis Boucher, Lucie Jobin, Lyne Jubinville et Raphaël Guérard
Tous membres du conseil d’administration du Rassemblement pour la laïcité.
Date de publication : 2025-02-12
Nous saluons le projet de loi-cadre du ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, qui concerne l’intégration nationale. Pour se convaincre de l’importance d’agir en ce sens, il suffit de rappeler quelques faits qui ont marqué l’actualité du Québec ces dernières années.
Souvenons-nous par exemple du « carnet d’outils » de l’Institut F, dont l’objectif était de « faciliter l’accès des femmes immigrantes et racisées aux services de leur quartier, afin de favoriser leur inclusion ». S’agissait-il d’offrir aux nouvelles arrivantes des informations sur leur pays d’accueil, les mesures d’accès à l’emploi, les institutions québécoises, la laïcité ou l’apprentissage du français ? Rien de tout cela. Le fascicule était entièrement destiné à « éduquer » ces femmes sur les fléaux du racisme, du néoracisme, de la « culture de la suprématie blanche », de la « colonialité », etc. Voilà une drôle de façon de favoriser l’intégration ou de faire aimer le Québec aux nouveaux arrivants !
Ce fascicule, financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, les amène plutôt à percevoir leur pays d’accueil comme un territoire hostile où elles peuvent être constamment victimes de racisme de la part de Québécois « de souche ». La loi-cadre sur l’intégration nationale permettra, on l’espère, d’éviter de dépenser l’argent du contribuable dans de tels projets diviseurs qui empoisonnent le vivre-ensemble.
On se souvient également des garderies subventionnées par l’État qui sélectionnent les enfants en fonction de leur religion ou de leur appartenance ethnique, ou de l’école Bedford prise en otage par des enseignants imposant leur langue, leur conception de l’éducation, et bafouant au passage l’exigence de neutralité religieuse des enseignants, la liberté de conscience des élèves et l’égalité entre les filles et les garçons. Parmi les solutions apportées par la direction de l’école, le rapport mentionnait des formations au multiculturalisme canadien ou la tentative « de rétablir des ponts » avec une mosquée et un centre communautaire religieux prônant le voilement des fillettes. Comment accepter ou même songer à favoriser un tel entrisme religieux dans nos écoles ?
Une loi sur l’intégration nationale aurait certainement constitué un outil précieux pour éviter certains écueils. Cependant, la situation semble principalement relever d’entorses à la laïcité de l’école et, pour y remédier, il faudrait davantage promouvoir la Loi sur la laïcité de l’État, l’assumer pleinement et se donner les moyens de la faire appliquer dans les établissements scolaires.
C’est pourquoi nous saluons particulièrement l’attendu de la Directive du ministre de l’Éducation concernant les pratiques religieuses dans les écoles (avril 2023), qui précise qu’« un élève a le droit d’être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l’exposer ou à l’influencer de manière qu’il se conforme à une pratique religieuse ». C’est aussi au nom de l’intégration et de la paix sociale que le Québec possède un intérêt légitime à contribuer à la formation de citoyens dont les normes religieuses n’ont pas à se substituer à la loi commune.
La laïcité comme modèle de remplacement au multiculturalisme canadien
Le multiculturalisme canadien encourage la fragmentation de la société en communautés où les pratiques et les signes religieux sont souvent considérés comme des marqueurs identitaires et communautaires. Loin de prôner la neutralité religieuse de l’État, ce modèle promeut plutôt la représentation des différentes religions dans l’espace public et étatique, et le respect presque absolu de toutes les pratiques religieuses. C’est ce modèle qui facilite la ghettoïsation et l’intégrisme religieux et qui prive des membres des communautés culturelles de leur droit à la liberté de conscience et de religion.
En effet, si la religion est considérée comme une caractéristique identitaire, ce n’est donc plus un choix. Comment, alors, parler de liberté ? À l’inverse, la laïcité de l’État consacre toutes les libertés, y compris les libertés religieuses, pourvu que celles-ci respectent la loi commune, n’imposent pas de contraintes aux coreligionnaires et n’isolent pas ceux-ci des autres citoyens.
La laïcité de l’État est donc un élément constitutif essentiel de l’intégration nationale, permettant d’éviter la ghettoïsation et de favoriser la cohésion sociale. Nous pensons qu’elle devrait davantage être présentée comme telle dans le projet de loi 84 (PL 84).
Par ailleurs, nous craignons que le fait de présenter la laïcité comme un trait « culturel » québécois crée de l’incompréhension auprès de personnes identifiées dans le projet de loi comme des immigrants ou des minorités culturelles. Rappelons que la Loi sur la laïcité de l’État a été défendue par des associations de culture musulmane ainsi que par de nombreux parents des minorités culturelles exigeant d’avoir accès à une école réellement laïque.
Ce sont d’ailleurs des enseignants et des parents provenant de l’Afrique du Nord qui ont d’abord dénoncé les agissements sectaires des enseignants de l’école Bedford et des nombreuses autres écoles ou garderies, car ce sont eux qui ont le plus à perdre de l’endoctrinement et de la radicalisation religieuse. Ce sont eux qu’il faut entendre, et non leurs « représentants » communautaires, pour lesquels ils n’ont pas voté et qu’encourage et finance le multiculturalisme canadien.
En d’autres termes, la menace contre la laïcité de l’État et les valeurs québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes, ne provient, malgré un temps d’adaptation parfois nécessaire, ni des immigrants ni des minorités culturelles, mais bien de l’intégrisme religieux et de sa volonté de rupture.
C’est pourquoi nous appuyons le PL 84 et sa valorisation du français comme langue commune, mais notre principale recommandation est de reconnaître la laïcité de l’État, non pas comme un élément parmi d’autres de la spécificité québécoise, mais bien comme fondement du modèle du vivre-ensemble et d’intégration nationale.

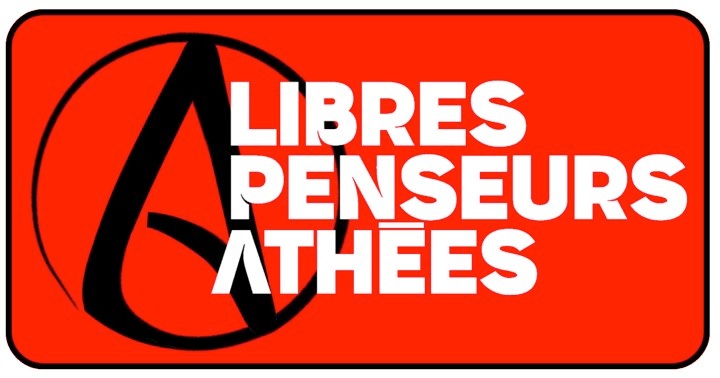
 AFT on Twitter
AFT on Twitter Alliance Athée Internationale (AAI)
Alliance Athée Internationale (AAI) Amis et amies de Libres penseurs athées
Amis et amies de Libres penseurs athées Atheist Freethinkers
Atheist Freethinkers Canal Youtube LPA-AFT
Canal Youtube LPA-AFT LPA-AFT sur Heylo
LPA-AFT sur Heylo Rassemblement pour la laïcité (RPL)
Rassemblement pour la laïcité (RPL)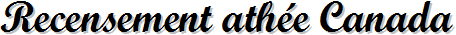 Recensement athée Canada
Recensement athée Canada
Laisser un commentaire